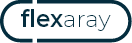L’orientation, la forme, les matériaux, les ouvertures… Tous ces choix architecturaux ont un impact sur l’efficacité énergétique du bâtiment, et donc sur son autonomie et sa durabilité dans un contexte de resserrement des exigences réglementaires. Les maîtres d’œuvre de constructions neuves et de rénovations globales doivent mesurer les effets de chaque décision sur la performance du bâti.
Les fondements de l’efficacité énergétique dans l’architecture
L’efficacité énergétique d’un bâtiment repose sur sa capacité à minimiser les besoins en énergie pour le chauffage, le refroidissement, l’éclairage et la ventilation, tout en assurant un confort optimal aux occupants. Ce principe est au cœur de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), qui favorise une approche globale intégrant la performance énergétique, l’impact carbone et le confort d’été.
Par exemple, l’architecture bioclimatique s’inscrit dans cette démarche en adaptant le bâtiment à son environnement pour tirer parti des ressources naturelles (soleil, vent, végétation) et réduire les besoins énergétiques. Elle cherche à concevoir des bâtiments en interaction avec leur environnement, en exploitant les conditions climatiques locales pour améliorer le confort thermique et réduire la consommation d’énergie.
Cette approche nécessite une compréhension approfondie des caractéristiques du site, telles que l’ensoleillement, les vents dominants, la topographie et la végétation environnante. En intégrant ces éléments dès la phase de conception, il est possible de maximiser les apports solaires en hiver, de favoriser la ventilation naturelle en été et de minimiser les pertes thermiques tout au long de l’année.
Les choix architecturaux majeurs influençant l’efficacité énergétique
Partant de cette base, plusieurs décisions architecturales doivent être mesurées afin d’évaluer la manière dont elles peuvent affecter le confort thermique et l’empreinte carbone du bâtiment.
Orientation du bâtiment
L’orientation du bâtiment est un facteur déterminant pour optimiser les apports solaires et la ventilation naturelle. Une façade principale orientée au sud permet de maximiser les gains solaires en hiver, réduisant ainsi les besoins en chauffage. En été, des protections solaires telles que des avancées de toit, des brise-soleils ou des végétaux à feuillage caduc peuvent limiter les surchauffes. Cette stratégie, au cœur de l’architecture bioclimatique, permet d’exploiter les ressources naturelles tout en maintenant un confort thermique optimal.
Forme et compacité
La forme du bâtiment influence la quantité d’échange thermique entre l’intérieur et l’extérieur. Une structure compacte (comme un cube ou un parallélépipède simple) réduit les surfaces de déperdition thermique. À l’inverse, des formes complexes ou allongées augmentent les besoins en chauffage et en climatisation.
Plus la forme du bâtiment est compacte, plus elle est favorable à une enveloppe thermique performante. La compacité est donc un principe clé dans toute démarche de conception passive ou basse consommation.
Choix des matériaux
Les matériaux utilisés impactent l’isolation, l’inertie thermique et l’empreinte carbone du bâtiment. Les matériaux biosourcés, tels que le bois, le chanvre ou la ouate de cellulose, offrent une bonne isolation et stockent du carbone. L’inertie thermique des matériaux lourds, comme la pierre, permet de lisser les variations de température, améliorant ainsi le confort thermique. Le choix des matériaux doit donc être adapté au climat local et aux objectifs de performance énergétique.
Gestion des flux d'air
Une ventilation efficace assure le maintien d’une bonne qualité de l’air intérieur. Le renouvellement de l’air contribue aussi au confort thermique en évacuant l’humidité qui tend à réduire la température ressentie. La ventilation naturelle, favorisée par une conception adaptée avec des ouvertures opposées et des cheminements d’air, peut réduire les besoins en climatisation en été. Des systèmes comme la ventilation mécanique contrôlée (VMC) double-flux avec échangeur de chaleur améliorent encore cette performance en hiver en récupérant la chaleur de l’air extrait pour préchauffer l’air entrant.
Conception des ouvertures
Les ouvertures (fenêtres, baies vitrées, puits de lumière) influencent à la fois les apports solaires, la ventilation et les besoins en éclairage. Leur dimensionnement et leur protection doivent faire l’objet d’une étude rigoureuse.
Le double ou triple vitrage, les vitrages à contrôle solaire et les menuiseries à rupture de pont thermique limitent les pertes de chaleur et les apports solaires excessifs. La surface vitrée totale d’une construction neuve doit représenter au moins 1/6 de la surface habitable, mais c’est aussi leur répartition qui conditionne l’efficacité.
Les ouvertures bien conçues favorisent également les apports de lumière naturelle pour réduire la consommation électrique en éclairage artificiel.
Ces choix architecturaux, intégrés dès la phase de conception, permettent de créer des bâtiments performants sur le plan énergétique, agréable à vivre pour les occupants et respectueux de l’environnement.
Exemples de réalisations exemplaires
Voici deux exemples d’architectures pionnières en France, réfléchies dans une optique d’efficacité énergétique.
L’Héliodome à Cosswiller dans le Bas-Rhin
L’Héliodome est une maison bioclimatique en forme de cadran solaire, orientée plein sud. Réalisée par l’inventeur Éric Wasser en 2013, elle permet de capter un maximum de chaleur en hiver et de rester fraîche en été, sans recours à des systèmes de chauffage ou de climatisation conventionnels.
La résidence Salvatierra à Rennes, en Bretagne
Conçue par l’architecte Jean-Yves Barrier, cette résidence collective passive et bioclimatique de 43 logements a été construite en 2001. Elle fait partie du programme européen CEPHEUS et vise une consommation énergétique réduite grâce à une conception optimisée.
L’intégration des réseaux techniques : un levier complémentaire
Au-delà de la conception architecturale, l’intégration des réseaux techniques (électricité, ventilation, chauffage) a un rôle à jouer dans l’efficacité énergétique et le confort. Une planification stratégique de ces réseaux permet de minimiser les pertes d’énergie, d’optimiser le fonctionnement des équipements et favoriser un environnement plus sain. Des solutions ciblées peuvent faciliter cette intégration dans le respect des objectifs de performance énergétique.
Pour les professionnels et les particuliers engagés dans des projets de construction ou de rénovation, prendre en compte l’ensemble de ces éléments dès la phase de conception est essentiel pour livrer des bâtiments plus autonomes et plus durables.