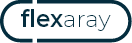Oui, la maison bioclimatique fera incontestablement partie du paysage résidentiel de demain. Cette approche architecturale, dont les fondements remontent aux prémices de la construction, fait le lien avec plusieurs autres concepts clés de l’habitat durable.
Une conception à partir de l'environnement
Le point de départ de l'architecture bioclimatique et toujours l'environnement de la construction.
Le premier paramètre à prendre en compte est le climat. L’amplitude thermique et l'ensoleillement, l'humidité et les précipitations, ou encore la vitesse du vent sont analysés.
Les matériaux localement disponibles apportent souvent une réponse adaptée à ces contraintes. Selon les régions, cela peut être, une bonne résistance à l’eau ou au rayonnement solaire.
Un bilan carbone naturellement réduit
Les constructions bioclimatiques ont un caractère propre et profondément rattaché à une zone géographique.
Cela permet de respecter naturellement les réglementations en vigueur pour la construction et la rénovation. Notamment les exigences portant sur l’origine des matériaux.
Pour réduire l’empreinte carbone des bâtiments, la réglementation environnementale RE2020 encourage le recours à des matériaux biosourcés produits à proximité.
Grâce à ces composantes, le bâti réduit la part des émissions carbonées associées au transport des matériaux et stocke davantage de carbone pendant sa durée de vie.
Un bâtiment bioclimatique chaque fois différent
Cet ancrage dans le territoire garantit aussi des constructions à l'aspect architectural unique.
La recherche d'un style distinctif traverse la plupart des mouvements contemporains pour l'habitat de demain. Elle est particulièrement présente dans les approches basées sur des éléments préfabriqués.
L'assemblage hors site réduit les coûts financiers et environnementaux d'un projet de construction, mais peut aussi reproduire des modèles sans âme. Les maîtres d'œuvre qui pilotent ces travaux cherchent des solutions pour prévenir l'uniformité qui pourrait découler de ces pratiques par ailleurs vertueuses.
C'est ainsi que, dans les mouvements de « tiny house » et de microarchitecture, s’est développé le souci de l'identité de la maison.
La conception bioclimatique étant définie par un environnement et des usages chaque fois différente, elle prévient naturellement les copier-coller de maison.
L’entretien et la réparation de la maison bioclimatique
Les conditions d’entretien d’une maison bioclimatique sont simplifiées par l’adaptabilité de ses composantes aux potentielles sources d’usure prématurée (vent, embruns marins, fortes chaleurs, activité sismique…).
En cas de dégradation ou de grave désordre, les composantes du bâtiment peuvent être rapidement et facilement remplacées. Non seulement les matériaux sont disponibles à proximité du site, mais les professionnels qui possèdent le savoir-faire pour les mettre en œuvre se trouvent plus facilement dans la région.
On retrouve ici une condition essentielle de l'approche low-tech. Dans le bâtiment, la basse technologie apporte les solutions concrètes et efficaces pour l'économie des ressources et l'autonomie des usages, mais en privilégiant toujours les moyens et les techniques simples et accessibles. Elle privilégie aussi les composants issus de production locale et pouvant être réparé sur place.
L'autonomie de l'habitat
Grâce à sa conception axée sur les contraintes et les ressources de l'environnement, la maison bioclimatique jouit d'une plus grande autonomie par rapport aux conceptions standardisées.
Dans les régions bénéficiant d'un fort ensoleillement, l'architecture bioclimatique prévoit une orientation et une pente stratégique des toitures destinées à accueillir des panneaux solaires photovoltaïques.
Partout où la nature des sols le permet, l'aménagement de puits canadiens, ou de pompes à chaleur géothermiques, assure le maintien d'une température confortable en été. Si le futur logement se trouve à proximité d'une forêt durablement gérée pour la production de bois de chauffage, les poêles et les inserts cheminées seront privilégiés.
Dans ces exemples, les sources d'énergie étant puisées sur place, les habitants sont mieux protégés contre les variations du prix de l'énergie et les éventuelles pénuries sur le marché.
Le recours à des sources d'énergie renouvelables et moins polluantes répond aux engagements pris par la France dans le cadre de la loi énergie-climat. Ces dispositions s'inscrivent dans le contexte plus général des objectifs fixés par l'accord de Paris et visant la neutralité carbone d'ici 2050.
Des espaces intérieurs plus sains
L'architecture bioclimatique cherche également à favoriser la circulation de l'air dans le logement.
Le renouvellement de l'air dans ces bâtiments est inhérent au fonctionnement des systèmes garantissant le maintien des températures intérieures de confort. Avec un puits canadien ou une VMC double flux, par exemple, les débits d'air permettent l'évacuation régulière des polluants qui s'accumulent inévitablement dans l'air ambiant.
Ces composés nocifs ou irritants peuvent être émis par les matériaux de construction avec des concentrations particulièrement élevées dans les premières années qui suivent la création et la pose du produit. La vapeur d'eau mal évacuée est un autre élément pouvant affecter la qualité de l'air intérieur.
L’approche bioclimatique se penche sur ces questions qui sont aussi traitées par les nouveaux labels de la construction durable, par exemple HQE, Haute Qualité Environnementale.
Au-delà de la qualité de l’air, d’autres formes de pollution peuvent également impacter le bien-être dans l’habitat. C’est le cas, par exemple, des rayonnements électromagnétiques émis par les installations du réseau électrique domestique.
Dans cette même logique d’amélioration du bien-être dans l’habitat, la question des rayonnements électromagnétiques prend de plus en plus d’importance. C'est dans cette logique que le produit Flexaray+ permet de compléter la démarche bioclimatique en offrant des gaines de protection contre ces rayonnements électromagnétiques.